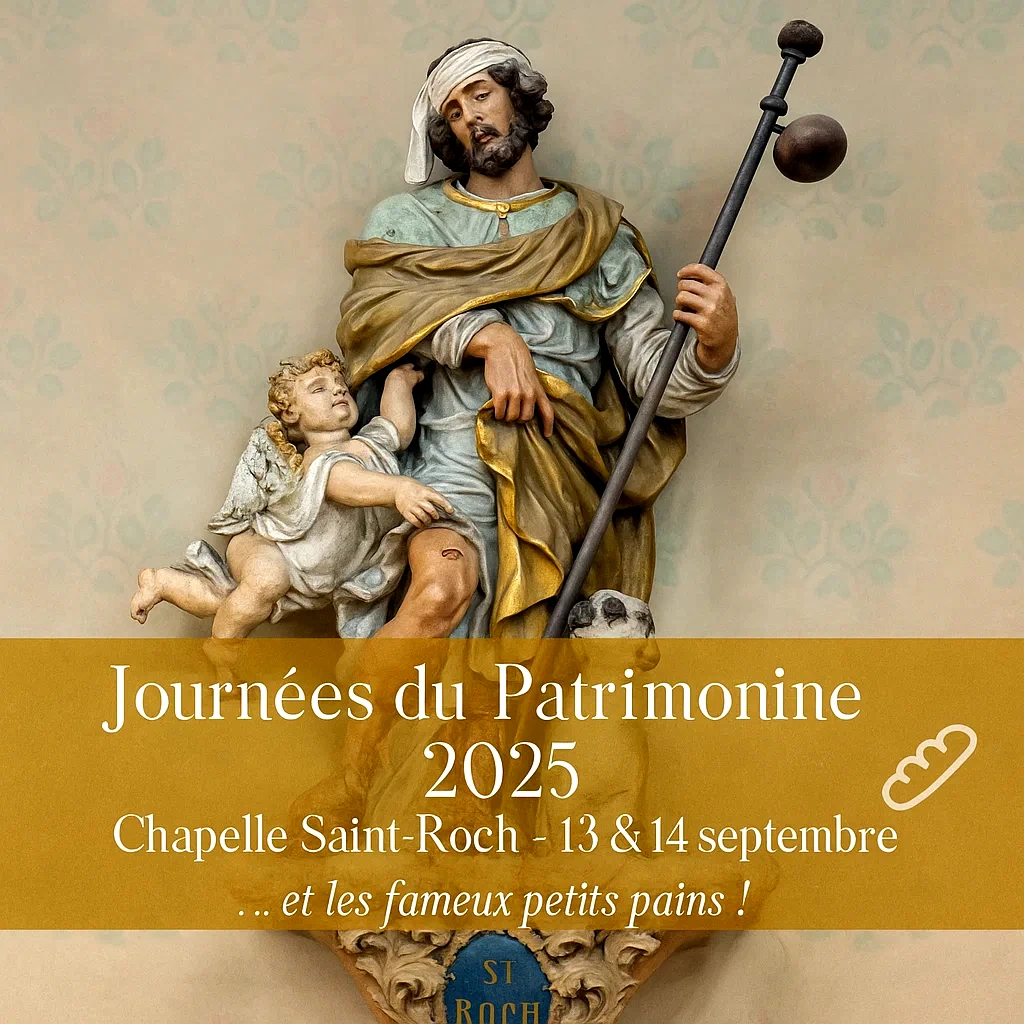La Maison Pirenne : quand un batelier érigea un palais sur la Meuse
Majestueuse, impeccablement alignée, la Maison Pirenne se dresse face à la Meuse comme un décor de théâtre. On la croirait née pour un noble ou d’un prélat… Pourtant, son créateur n’avait ni titre, ni armoiries. Simplement une barge, du flair et de l’ambition. Voici comment Arnold Bauduin, marchand-batelier de Coronmeuse, transforma ses cargaisons en gloire architecturale.
Un palais sur la Meuse
Posée face au fleuve comme une actrice principale sur sa scène, la Maison Pirenne attire l’œil depuis plus de deux siècles. Ses lignes régulières, son fronton éclatant, sa symétrie presque insolente semblent proclamer : « Ici vivait quelqu’un d’important. » Aujourd’hui encore, les passants s’interrogent : noble résidence ? maison de maître ? ancienne institution ? La vérité est plus savoureuse : cette demeure n’est pas née de la poudre des perruques aristocratiques, mais de la sueur des bateliers. Elle ne fut pas l’œuvre d’un comte ni d’un magistrat, mais d’un homme du fleuve, un certain Arnold Bauduin. Un homme qui choisit, en 1765, de faire graver dans la pierre sa réussite. À la vue de tous.
Arnold Bauduin : des amarres à la bourgeoisie
Tout commence loin des salons mondains, à Fumay, petite localité des bords de Meuse, là où l’on apprend à naviguer avant même d’apprendre à lire. Son père, Dominique Bauduin, batelier respecté, sillonne la rivière jusqu’à Maastricht, où la famille s’installe au début du XVIIIᵉ siècle. Arnold y grandit, non pas entre parchemins, mais entre cordages, cargaisons et barges aux odeurs de vin, d’épices et de tabac.
Mais ce n’est pas un simple héritier : il voit plus grand que son père. En 1741, à 25 ans, il quitte les quais de Maastricht pour la cité voisine de Liège, cœur battant du commerce mosan. Il y épouse Marie Loneux, fille d’une famille locale, et s’installe dans la paroisse de Sainte-Foi. Le batelier étranger devient époux liégeois. Puis, en 1757, il franchit une étape décisive : il obtient la bourgeoisie de Liège, ce précieux sésame qui fait d’un homme du peuple un citoyen reconnu. Il n’est plus seulement un homme de passage. Il devient un homme en place.
Coronmeuse : l’eldorado fiscal du XVIIIᵉ siècle
Choisir un emplacement pour une maison, c’est toujours déclarer une intention. Or Bauduin ne choisit pas n’importe où : il construit à Coronmeuse, juste au bord du fleuve, à l’endroit exact où Liège s’arrête et où Herstal commence. Une frontière ? Non : un entre-deux propice à toutes les audaces.
Car Coronmeuse, au XVIIIᵉ siècle, n’est pas un simple faubourg. C’est le Far West fiscal du pays liégeois. Cette bande de terre, longtemps protégée par le statut de terre franche du Brabant puis possession du roi de Prusse, bénéficie de droits d’octroi avantageux. En clair : on y entrepose, on y échange, on y négocie… sans trop se soucier des douaniers. Le vin y dort tranquillement dans les celliers, le tabac s’y empile en ballots, et les épices y transitent comme par magie. Les autorités liégeoises tentent bien de reprendre la main en installant un bureau d’octroi en 1752, mais trop tard : les négociants ont déjà pris leurs marques. Et Bauduin en fait partie.
Il comprend tout : pour prospérer, il faut être au bon endroit. Et pour être respecté, il faut le montrer. Alors il bâtit.
La demeure de 1765 : un rococo de revanche sociale
Ce que Bauduin construit en 1765 n’est pas une simple maison : c’est une proclamation en pierre.
Le style ? Louis XIV-Louis XV à la liégeoise, ce qu’on appelle aussi rococo régional. Mais ici, la fantaisie est moins frivole qu’il n’y paraît : elle est calculée. Chaque élément architectural semble dire « Moi aussi, j’ai droit à la grandeur ».
-
La façade, rectiligne mais animée de légers ressauts, capte la lumière comme une peau satinée. Elle est bâtie dans cette pierre blonde typique du pays mosan, polie pour renvoyer le soleil de la Meuse.
-
Les fenêtres, hautes et régulières, rythment la composition comme les pas d’un défilé militaire, mais avec la grâce d’une valse. Rien n’est laissé au hasard : la symétrie est une discipline, presque une déclaration de légitimité.
-
Au centre, un fronton ou ornement sommital (à préciser si décrit dans la suite du texte) vient coiffer l’édifice comme une couronne. Certains nobles le font sculpter avec leurs armoiries. Bauduin, lui, n’a peut-être pas d’écu ancestral… mais il a une adresse. Et elle suffit à faire office de blason.
Et surtout : la maison ne se cache pas. Elle s’offre au regard. Pas nichée en retrait, non. Plantée en bordure du quai, visible de tous ceux qui passent en barque ou en diligence. Mieux encore : elle défie les palais urbains du centre-ville en se donnant des airs aristocratiques — sans en être.
C’est là toute la force de cette façade : elle n’imite pas la noblesse, elle la concurrence. Elle dit au passant : « Regarde-moi bien. Je suis né batelier. Et maintenant, je bâtis comme un seigneur. »
Au XVIIIᵉ siècle, rares sont ceux qui ont le courage — ou l’audace — de s’élever en dehors des chemins balisés par la naissance. Arnold Bauduin, lui, choisit la pierre comme arme sociale. Là où d’autres accumulent les titres, il érige une façade. Là où les nobles exhibent leurs blasons, lui expose sa réussite sur les quais. Sa Maison Pirenne n’est pas seulement belle : elle raconte un passage. Celui du batelier au notable, du marchand au maître.
Et ce n’est que l’extérieur.
Car derrière ces murs impeccablement alignés, l’homme du fleuve n’a pas seulement voulu impressionner — il a voulu éblouir. Cheminées sculptées, peintures murales, décors inattendus : l’intérieur de la Maison Pirenne cache un théâtre intime, où chaque pièce semble proclamer « Ici vit celui qui a osé ».
La façade avait parlé haut. L’intérieur, lui, chuchote encore des secrets…
Et c’est ce que nous découvrirons dans le prochain article :
« Derrière la pierre : les fastes intérieurs de la Maison Pirenne »