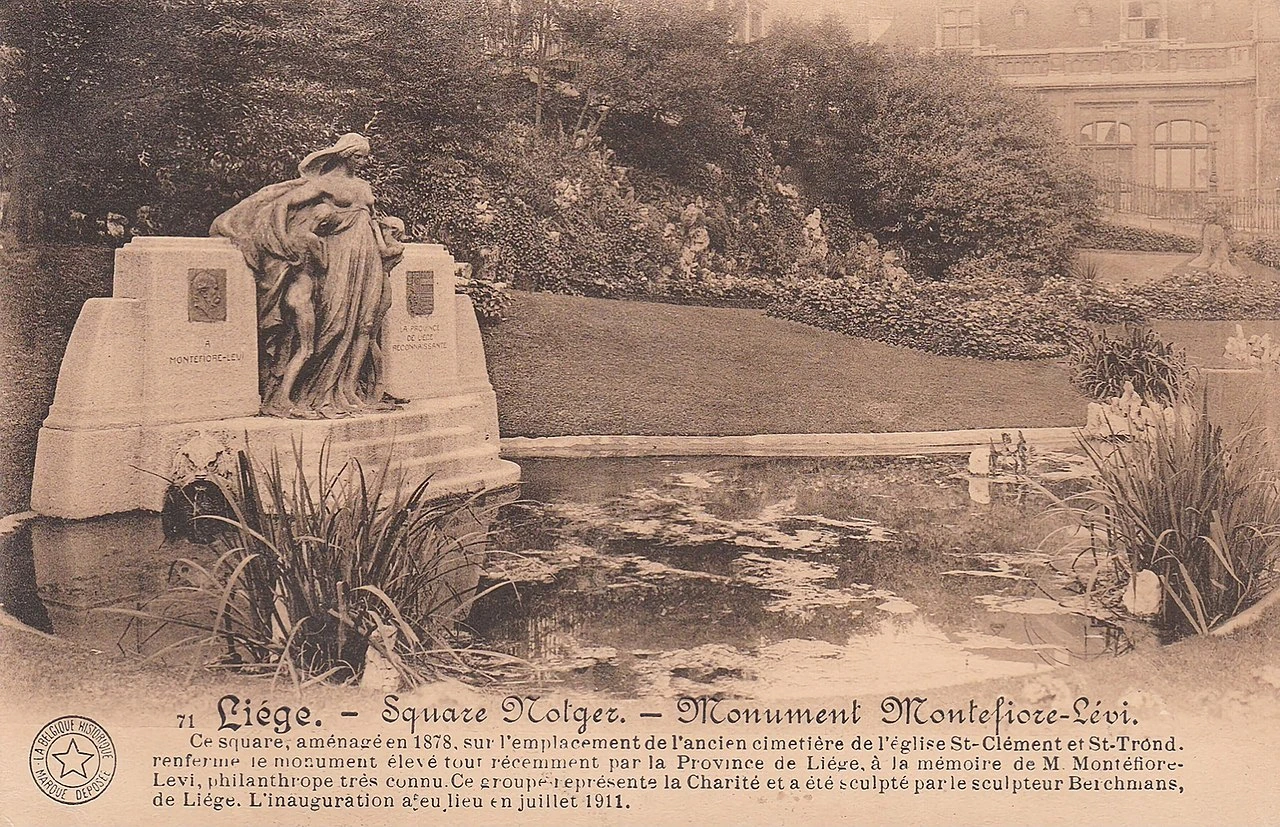Derrière la façade Art nouveau de la Maison Demanet : la naissance d’un foyer clandestin à Liège
Liège regorge de trésors architecturaux, parfois dissimulés dans le tissu dense de ses quartiers anciens.
Au n° 11 de la rue de la Justice, une façade attire depuis 1903 les regards curieux : celle de la maison Demanet, œuvre élégante de l’architecte Joseph Bottin, mélange de lignes éclectiques et de courbes Art nouveau. Une demeure lumineuse, raffinée, pensée pour un négociant en vins de la Belle Époque.
Et pourtant, derrière cette façade élégante, s’est joué l’un des épisodes les plus graves et les plus méconnus de l’histoire liégeoise. Dans cette maison redevenue aujourd’hui silencieuse, la Résistance y a trouvé refuge, conseils, abri — et bientôt le drame.
C’est là que commence l’histoire de Paul Dufour, un homme dont l’engagement a marqué à la fois la ville et ceux qui y vivaient.
Un homme de devoir avant d’être un clandestin
Paul Dufour n’est pas encore un résistant lorsqu’il s’installe avec sa famille dans la maison Demanet.
Né en 1896 à Morlanwelz, il appartient à cette génération d’hommes façonnés par les crises du XXᵉ siècle : rigoureux, discret, profondément attaché à son pays. Ingénieur de formation, spécialiste des questions militaires, il se distingue par un sens aigu de la responsabilité et du service.
Quand la guerre éclate, Paul Dufour ne se précipite pas dans la clandestinité. Comme beaucoup, il observe, analyse, mesure les risques.
Mais l’Occupation, les tensions croissantes à Liège, la répression contre les ouvriers, les techniciens et les intellectuels le poussent progressivement vers un choix qu’il sait dangereux : agir.
Entrée dans l’ombre : le réseau « Bayard »
Début 1943. À Liège, plusieurs réseaux de renseignements se renforcent pour combattre l’Occupation. Parmi eux, « Bayard », fondé par des parachutistes belges et réputé pour son organisation souple et sa capacité à transmettre rapidement des informations stratégiques à Londres.
C’est ce réseau que Paul Dufour rejoint.
Et rapidement, il y trouve sa place.
Il observe, note, structure :
– les mouvements de troupes,
– les types de chars et de canons transportés,
– les trains, leurs chargements, leurs destinations,
– les changements dans l’organisation allemande.
Ses rapports sont précis, fiables. Londres les considère comme utiles, parfois cruciaux. « Bayard » le sait : Dufour est un élément solide.
La maison Demanet : refuge discret, carrefour clandestin
C’est alors que la maison du n° 11 devient plus qu’un simple foyer.
Grâce à sa position centrale et à la protection discrète offerte par son architecture, elle se transforme en point de rendez-vous pour résistants et ouvriers inquiets de l’avenir.
Dans un coin du salon, une machine à écrire claque chaque lundi. C’est Madame Dufour, Renée, qui dactylographie les messages destinés à Londres. Les rapports passent ensuite de main en main, suivant des itinéraires clandestins qui serpentaient entre la France, la Belgique et les radios alliées.
Le soir, la maison s’anime encore différemment : on vient y chercher un conseil, un contact fiable, de faux papiers, une carte de ravitaillement, parfois un simple avis pour échapper à une réquisition.
Parmi ceux qui franchissent la porte, de nombreux ouvriers de la MAE (Manufacture d’Armes de l’État), menacés d’être envoyés travailler pour l’effort de guerre allemand.
Paul Dufour les reçoit calmement, avec une parole ferme :
« Pas une heure de travail pour les Allemands. »
À ses yeux, refuser la collaboration est un acte de loyauté envers le pays — parfois le premier pas vers la résistance active.
L’ingénieur qui enseignait les explosions
Mais Dufour n’est pas seulement un conseiller.
Sa connaissance des armes et des explosifs le place au cœur d’une autre activité dangereuse : la préparation des sabotages. Il explique comment placer une charge, où positionner un détonateur, comment s’assurer que le sabotage fera réellement effet.
Il enseigne, corrige, accompagne.
Ses conseils s’avèrent précieux pour les partisans qui visent des infrastructures essentielles : rails, dépôts, transformateurs.
Ainsi se dessine le portrait d’un homme complet, à la fois intellectuel, technicien, stratège et pédagogue, toujours au service de la lutte clandestine.
Une famille unie dans l’ombre
Dufour partage rarement ses inquiétudes, mais il sait que sa famille est exposée.
Trois enfants vivent sous ce toit devenu foyer clandestin : Robert, Simone et Marc.
Des enfants qui, sans comprendre tous les détails, voient des inconnus défiler, entendent des bribes de conversations, perçoivent la tension.
Ses amis l’avertissent :
« Paul, fais attention. Pense à ta femme, pense aux enfants. Arrête ou mets-toi à l’abri… »
Il répond avec un sourire léger :
« Si la Gestapo vient, je m’évaderai par les jardins. »
Une phrase devenue célèbre dans les témoignages.
Une phrase qui, avec le recul, sonne comme une prémonition tragique.
La menace qui s’approche
Mais en 1943, Paul Dufour ignore encore ce qui se prépare.
La maison Demanet reste un refuge, mais elle attire aussi les regards ennemis. L’étau se resserre, les arrestations se multiplient, les informateurs s’activent.
Les tensions montent, lentement mais sûrement.
Cet épisode s’arrête ici, au bord du précipice.
L’engagement de Dufour, l’importance de la maison de la rue de la Justice, la fragilité de l’équilibre familial : tout est en place.
Dans le second épisode, nous entrerons dans l’ombre la plus profonde celle du 15 janvier 1944, au petit matin, lorsque la porte de la maison Demanet s’ouvrira sur un drame, dont personne, à Liège, ne soupçonnera l’ampleur.